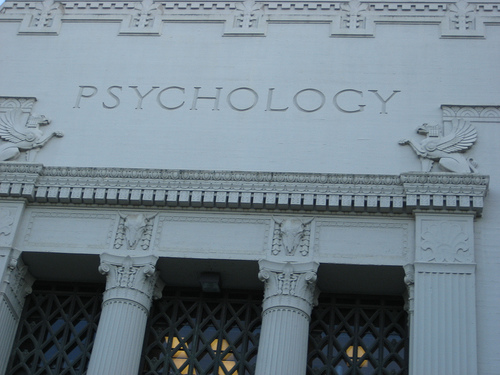 © Jacob Erickson
© Jacob EricksonDésormais, des thérapeutes musulmans peuvent être sollicités par des patients musulmans, ce qui n’était pas le cas il y a une ou deux décennies. En parallèle, la demande croît également et nous musulmans avons davantage besoin de soins psychologiques. Phénomène de mode ou non, le constat est clair. S’il est aujourd’hui possible de consulter un psy musulman, voyons les critères pertinents pour faire son choix.
Choisir son psy
Dans ma pratique, j’ai pu constater deux cas de figure : d’une part des personnes convaincues que ce choix est préférable afin d’être mieux comprises, afin d’être plus à l’aise du fait d’une culture religieuse proche et du besoin de pouvoir dire des choses de manière totalement libre. Ce fantasme de terrain commun est très rassurant. Il va permettre à certaines personnes justement d’aborder des sujets qu’elles n’oseraient pas aborder (djinns, maltraitance familiales, victime de racisme ou d’islamophobie, mépris…) devant un thérapeute ne partageant pas la même culture religieuse, les mêmes codes de peur qu’il ne comprenne pas ou qu’il dramatise la situation.
D’autre part, il y a les patients qui ont d’abord consulté un thérapeute non musulman, puis qui se sont rendu compte, à un stade avancé du travail, qu’ils n’étaient plus aussi à l’aise qu’au début des séances, car il fallait aborder des points plus personnels et privés liés à la personnalité. A ce moment-là, ces patients décident de changer de psychologue et diront avoir senti une sorte de « barrière ».
Rassurer sur l’absence de jugement
Ma posture a évolué par rapport à cette idée. Lorsque j’ai commencé la pratique en libéral, je pensais qu’il n’était pas nécessaire de consulter chez un thérapeute qui partage la même culture religieuse que moi, ce pour deux raisons.
Premièrement, j’avais moi-même fait l’expérience lors de ma psychanalyse – démarche très recommandée lorsque l’on souhaite pratiquer en libéral – avec une psychanalyste non musulmane, ainsi que lors d’un travail de supervision de pratique, là encore auprès d’une psychologue non musulmane.
Tant le travail que les relations furent très satisfaisants. Deuxièmement, je pensais aussi que face à une psychologue musulmane une patiente musulmane pourrait ne pas avouer certains faits comme une intervention volontaire de grossesse (IVG) ou tentative de suicide, par peur du jugement puisque cela est interdit en islam.
La thérapie avec un psychologue musulman
Or, l’expérience a prouvé l’inverse : un patient musulman ne se sentira pas forcément mal à l’aise. Plus le thérapeute est compétent et le cadre est rassurant, structurant, étayant, plus les patients réussissent à se libérer totalement et à dire des choses qu’ils ne pensaient jamais pouvoir exprimer devant une personne de même confession.
Le choix du psychologue et le succès de la thérapie sont finalement liés au professionnalisme et à l’absence de jugement.
L’intérêt avec un psychologue musulman, c’est qu’il n’est pas nécessaire de tout expliquer ni de justifier sa croyance. Les patients qui sentent que leur foi est attaquée, qui risquent de divorcer, qui voient leurs ados fumer ou contredire constamment leurs parents, ont besoin que l’on comprenne pourquoi c’est une source de souffrance.
Ces patients musulmans ne souhaitent pas s’entendre dire que « la religion est un amas de contraintes » ou « dans votre cas vous devez divorcer » ou bien « mais c’est normal, à l’adolescence l’enfant a besoin de faire de nouvelles expériences ».
Cas clinique : Walid, 14 ans
M. et Mme B. avait consulté pour leur fils Walid, 14 ans, qui s’était mis à leur désobéir, à avoir de mauvaises fréquentations et à fuguer. Son mauvais comportement prenait de l’ampleur. Les fugues furent ce qui déclencha la demande d’aide. Le premier psychologue – non musulman – qu’ils avaient été voir avait répondu que son attitude n’était pas grave, qu’elle ne présageait pas un avenir dans le grand banditisme et que ce genre de comportement était classique, voir banale à cet âge.
Un adolescent a besoin de se détacher de la sphère familiale pour investir l’extérieur et ainsi acquérir son autonomie. Ce thérapeute avait jugé inutile de faire une thérapie.
Insatisfaits, les parents de Walid choisissent de venir me consulter. Ils me racontent alors la situation et m’expliquent alors pourquoi ils ont cette fois opté pour un thérapeute musulman.
Puis, je reçois Walid et lui demande alors ce qu’il pensait de la réponse du psychologue qui l’avait reçu avant moi. Walid répondit qu’elle ne lui convenait pas, car en tant que musulman il voulait un positionnement qui aille dans le même sens. Nous avons essayé de comprendre ce qui le poussait à agir ainsi. La thérapie familiale a permis de proposer une cohérence et un équilibre entre les règles parentales et les besoins de « liberté » de cet adolescent.
Des psychologues dans le jugement
Un certain nombre de psychologues se permettent de juger le mode de vie des patients qui pratiquent une religion, leur tenue vestimentaire, le choix de ne pas vouloir travailler, etc. Ces thérapeutes sortent de leurs prérogatives pour entrer dans le jugement : ils savent pertinemment que leurs patients ne manifesteront pas d’opposition, faute de connaître leurs droits.
Or, ce faisant, ces psychologues ne respectent pas l’article premier du code de déontologie qui exige le respect de la réalité psychique du patient. L’absence de jugement est une règle fondamentale, qui est cependant, dans ce climat d’islamophobie croissant, de moins en moins respectée.
Tout patient doit se demander pourquoi il consulte. C’est une démarche qui demande beaucoup de courage. Il faut accepter de se livrer et être prêt à être surpris par ses propres mots lorsqu’ils ressurgiront de l’inconscient.